 PRISONNIERS : LE TEMPS DES CAMPS
PRISONNIERS : LE TEMPS DES CAMPSPrisonnier !
Après un repli d'une centaine de km., chargé comme un mulet sans sommeil, sans beaucoup de nourriture avalée à la va-vite, et toutes ces cavalcades le long du canal de la Marne au Rhin : tout ça pour ça !
Un grand diable nous regroupait en aboyant et nous montrait la direction à prendre, j'appris qu'il s'agissait d'un feldwebel, l'équivalent du grade d'adjudant chez nous.
En passant près d'un blessé, un « marsouin » (il y avait de tout dans cette nasse ! ), j’ôtais ma capote, en retournais les manches, y enfilais deux fusils abandonnés là, boutonnais la capote et plaçais le blessé sur ce brancard improvisé : le pauvre n'était pas brillant, blessé au ventre, il réclamait à boire et nous ne pouvions rien lui donner…
Je me fis aider pour le transporter à l'arrière quand le feldwebel nous ordonna de la poser à terre et de continuer dans la direction qu'il nous indiquait. J'eus le temps de l’apercevoir dégainer son Luger… Je ne me retournais pas quand j'entendis le coup de feu : il venait d'achever « mon » blessé !
J'oubliais ma capote contenant mes papiers, mon livret militaire, mes clefs, les lettres de ma mère, j'étais trop bouleversé pour réagir : je me retrouvais donc en bras de chemise, le pantalon déchiré par les barbelés et sur la tête la coiffe de mon casque qui était précédemment parti en chandelle : une sacrée dégaine pour un militaire !
Le feldwebel nous montra un blessé allemand allongé sur une échelle et nous fit comprendre que nous serions plus utiles à le transporter qu'aider un moribond…
Transportant le blessé sur son brancard-échelle, nous arrivâmes près du canal qu'il fallait traverser.
Pour en faciliter le franchissement lors de leur attaque, les allemands avaient relevé au maximum les crémaillères des portes écluses pour vider l'eau et en avaient jeté les manivelles à l'eau, ainsi les crémaillères remontées dépassaient la passerelle de plus de deux mètres !
Le problème était que cette passerelle d'écluse présentait un angle d'environ 150° et que son franchissement était donc problématique du fait de ces p… de barres de crémaillères qui interdisaient tout passage en ligne droite.
Le feldwebel n'avait pas omis de nous avertir que si le blessé tombait à l'eau, ses soldats qui nous braquaient ne nous ne rateraient pas.
Une sueur glacée m'avait soudain inondée : aurais-je assez de forces ? Et l'autre, celui qui avait été désigné de l'autre côté du brancard, était-il lui aussi assez costaud ? Je lui expliquais cependant, malgré mon cœur qui battait la chamade, d'économiser ses forces, de procéder lentement au passage de l'angle des portes car à ce moment nous serions en porte-à-faux au dessus du vide avec en bouts de bras le blessé et ses 70 kg.
Nous avons cependant réussi me demandant encore quelquefois quelle bonne étoile avait veillé sur nous ce jour là !
Je crois encore aujourd'hui, à la rédaction de ces pages, que le franchissement de cette écluse fut l'une des épreuves la plus éprouvante de mon existence ! (NdR : effectivement il nous en a souvent parlé en famille, ce souvenir semblait revenir le hanter périodiquement dans ses cauchemars
Avec quelques centaines d'autres, nous avons été parqués dans un pré à vaches clos de barbelés gardé par quatre allemands, pistolet mitrailleur au poing. (c'est à ce moment que je remarquais qu'ils étaient tous armés de mitraillettes)
Nous étions le 18 juin 1940 vers 17 heures. Je dormi à même le sol, en bras de chemise, comme une bête jusqu'au petit matin.
Des lors, le troupeau que nous étions était emmené Dieu sait où lors d'une marche silencieuse.
Lors d'une pause dans un petit village, je rassemblais quelques souvenirs de langue allemande, réminiscence de mes études faites à Strasbourg dans mon jeune âge, pour demander d'aller me laver à la fontaine proche. J'avais encore sur moi l'épouvantable odeur de tripes et de sang de « mon » pauvre marsouin.
A quelques pas de là, un officier allemands (Un chef de bataillon d'après ce que je crus comprendre) , entouré d'une cour d'officiers et de secrétaires, plastronnait l'air très satisfait : toutes les minutes des motards arrivaient lui annonçant la prises d'une nouvelle ville ! J'en étais abasourdi !
J'en étais à me laver et boire à la fontaine lorsqu'un officier allemand s'adressa à moi en un français un peu « précieux » : « Mon cher ami, aimeriez-vous goûter à notre excellent moka? »
Devant ma mimique incertaine, il fit signe à un de ses hommes de me servir dans un quart un liquide tiédasse. Aussitôt goûté, je fis une horrible grimace, le jus s'avérant un affreux ersatz, genre glands grillés, tandis que l'officier se tordait de rire, apparemment satisfait de sa plaisanterie…
Après plusieurs heures de marches nous arrivâmes aux ruines d'une grande usine de fabrication de chaussures : Bataville.
Celui-ci, Bata, un juif tchèque, avait implanté en France cette entreprise qui prospérait dont les allemands s'étaient fait un plaisir de démolir l'usine à coups de canons. Ne restait debout qu'un grand hall au rez de chaussé qui abrita bientôt quatre cents prisonniers.
Vint la fouille par les feldgendarmen, brutaux , aboyant des ordres que la plupart ne comprenaient pas, nous dépouillant cependant de tous nos objets personnels. Quant à moi, n'ayant plus rien sur moi, cela sembla déclencher la fureur de celui qui me fouillait : il m’arracha ma montre et tenta de l'écraser du talon de sa botte. Je ne sais pas comment il s'y pris pour manquer son coup, toujours est-il que je réussi à la récupérer façon prestidigitateur, la planquant sur le dos de ma main tandis qu'il retournait mes poches. J'avais toujours ma coiffe de casque, ce qui ne semblait déranger personne : tant mieux car j'y avait planqué, roulé en boule, un billet de 50 francs, ne sachant pas encore si cela pourrait me servir un jour.
Je devais ainsi dormir plusieurs nuits, en bras de chemise sur le carrelage glacé de Bataville avant de retrouver quelques vêtements car ce séjour ici devait durer 1 mois.
Nous étions nourri d'une louche de soupe très claire par jour et d'une boule de pain pour 12 . Ce pain était celui des réserves de l 'armée allemande, le fameux pain « KK » stocké depuis des mois dans les casemates de la ligne Siegfried, vert de moisissures, effrité quasiment impossible à couper et partager correctement. Une fois par semaine un ou deux kilos de viande étaient bouillis dans quatre cents litres d'eau, la viande surnageant en surface, s'était la cohue pour se faire servir en premier ! A l'inverse, quand il arrivait au cours d'une semaine que quinze kilos de haricots soient bouillis, ceux-ci tombés au fond, c'était l'émeute pour être placé dans les derniers de la file…
L'eau nous était distribuée chichement : nous étions ravitaillés par une tonne tractée par un cheval, toutes les canalisations ayant été éventrées lors des bombardements. J'avais réussi à récupérer une grosse boite de conserve vide ce qui me permettait de laver un peu mes vêtement souillés par les poux et la sueur , et de garder un peu de cette eau si précieuse.
Volontaire pour les corvées qui me permettaient quelquefois de m'extraire de cet univers lamentable et je parvins, lors d'une corvée d'aide au déménagement d'une allemande du village, à me faire donner par elle quelques vêtements, chaussettes et même un pain de savon de Marseille !

Au passage, j'observais qu'ici les habitants n'avaient pas été évacués et qu'un facteur continuait même à distribuer le courrier !
Je fini par convaincre un jeune soldat allemand qui parlait, lui, un peu de français de me poster une lettre dans une boîte toute proche, que je lui avais préalablement lue, afin de donner de mes nouvelles à ma famille. Il fit d'abord quelques manières : c'est défendu, je risque d'être puni, etc...Mais fini par accepter.
Un soir, nous vîmes cinq ou six prisonniers qui furent mis à l'écart à genoux, mains sur la tête : c'étaient des polonais que nos gardiens avaient trouvé parmi nous. Quelques jours plus tard, nous les vîmes partir avec des pelles accompagnés de leurs gardiens : nous vîmes revenir les gardiens, mais pas les polonais.
Pour nous, l'affaire était claire : on leur avait fait creuser leurs tombes avant de les fusiller !
Imaginez notre rage, nos sentiments de haine mêlés d'impuissance. Mais j'étais surtout bouleversé : comment pouvait-on descendre aussi bas dans la barbarie, ce n'était plus de la guerre et tout devenait-il permis ? Nous n'étions malheureusement pas au bout de notre écœurement ainsi que nous le vîmes un peu plus tard…
Plusieurs camions arrivèrent déversant des troupes originaires du sud de la France. Elles s'étaient rendues, officiers en tête, avec armes et bagages, mais n'avaient pas oublié de se servir en route au vu du bazar inénarrable qui les accompagnaient : sans doute fruit de pillages, car pas d' objets militaires du tout !
Un soir que j'allais dans l'aile du bâtiment où ils installaient leurs couchages et je vis beaucoup de magnifiques matelas et de belles couvertures. Avisant un gaillard qui possédait 6 couvertures à lui seul, je lui demandait de m'en donner un : il refusa tout net et m'envoya grossièrement paître.
J'allais chercher mes compagnons, tout aussi démunis que moi côté couchage et leur proposa d'aller se servir. Ceux qu'on appelait maintenant « les marseillais » furent tellement ébahis de ce culot qu'ils ne réagirent et se laissèrent faire. Seules, une ou deux grandes gueules voulurent faire le coup de poing, rapidement calmés par nos bûcherons vosgiens et mineurs lorrains !
Il y eut cependant quelques épisodes moins tragique : ainsi celui du « camion de pommes de terres fantôme ». Ce camion arrivait pour faire une livraison de pommes de terre. Mais à peine arrivé, il fut pris d'assaut par nos gars qui bourraient leur pantalon, serrés aux chevilles, de patates. Le chauffeur allemand hurlait, des sentinelles arrivèrent en courant et tirant en l'air, mais rien n'y fit : en moins d'une minute, avant l'arrivée de la gardes, il ne restait plus sur le plateau du camion qu'un peu de terre et quelques rogatons de pommes de terre.
Les hommes avaient récupéré quelques briques qui permettaient d'installer des « petits feux » alimentés avec des bois issus des poutres et des huisseries de l'usine démolie. Un système de « double gamelle » était utilisé pour déjouer les recherches de nos gardiens toujours à la poursuite de leurs patates : la gamelle du dessus servait à laver le linge et en éliminant les poux, tandis qu'une deuxième planquée au dessous laissait cuire les légumes .Les sentinelles sondaient les gamelles avec leurs baïonnettes et n'y trouvaient que des caleçons ou des maillots de corps, mais pas de patates !
Leur officier hurlait des grossièretés d'où il ressortait « que ces cochons de français devaient rendre les patates. »
Les allemands n'en ramenèrent pas beaucoup, mais nous avertirent que puisqu'on s'était servis, ils n'en donneraient pas d'autres...
Un jour, un officier nous harangua par interprète interposé : »vous pouvez écrire à vos familles deux fois par semaine et mettre vos lettres dans une boite placée à l'entrée à cet effet. Pour le papier et les crayons, débrouillez vous comme vous en avez la réputation. »
Je découvris un peu plus tard que le papier de la boite aux lettre servait aux cuisiniers pour allumer leurs feux !
Le café aux glands, la soupe aux betteraves avachies et la boule pain pour douze ne nous donnaient pas une forme physique très brillante.
Les bruits les plus invraisemblables circulaient : on allait nous libérer, Pétain avait pris les choses en main, avait soi-disant signé un accord avec Hitler, etc.
Les allemands de leur côté confirmaient : "vous guerre finie, bientôt renter cher vous..." Finalement, nous fûmes rassemblés et conduits...vers l'Allemagne !
Le premier jour on nous fit faire 30 Km. Nous étions crevés et marchions comme des automates et les allemands qui nous encadraient avaient le coup de crosse facile pour ceux qui traînaient la jambe.
Sur le chemin, nous croisions des compagnies allemandes qui marchaient vers la France, leurs chants scandés de leur pas cadencé, l'arme à la bretelle, calot passé dans l'épaulette de la chemise, petit bidon à la ceinture, précédés d'un officier à cheval : ils avaient fière allure en comparaison du troupeau misérable que nous formions.
Le lendemain nous fûmes parqués dans une cour de caserne à Saint Avold pour y passer la nuit en attendant une nouvelle marche de 30 Km .
Enfin nous prîmes la route en direction de Sarrebruck par Forbach et String-Wendel : c'est dans ce dernier parcours que se situe un fait dont il faut que je témoigne.
Notre route traversait un village où cantonnaient de très jeunes soldats allemands. Au repos, ils se rasaient, ciraient leurs bottes dont ils prenaient grand soin.
Tout à coup, devant nous il y eu une bousculade et le convoi s'arrêta. Les jeunes allemands avaient aperçu dans nos rangs trois prisonniers à la peau noire ainsi qu'il y en avait dans nos compagnies : ils coururent enfiler leurs bottes, prirent leurs armes et lynchèrent les malheureux sur place à coups de talons leur perçant le corps de leurs baïonnettes. Nous étions terrifiés, tandis que nos gardiens nous tenaient sous la menace de leurs armes !
Quand la marche repris, le cœur serré, nous dûmes passer près de la bouillie sanglante des restes de nos malheureux compagnons d'armes.
Vengeance à retard de la soi-disant barbarie des troupes coloniales de la première guerre de 14/18 ?
Barbarie entretenue dans l'imaginaire collectif allemand par une propagande raciste au service du pouvoir : certainement et nous étions témoins impuissants des résultats sur les esprits de ces très jeunes hommes.
Après ces épuisantes épreuves, et ces marches forcées, nous étions harassés et à bout de force. Beaucoup chancelaient. Ainsi que d'autres, je soutenais un camarade plus affaibli que moi.
Mais derrière nous, en queue de la file, les coups de feu claquaient : les allemands réglaient à leur manière le problème des traînards...
Plus tard, après une pause, un de mes voisins ne se releva pas : il était mort ! Exténué ? Défaillance cardiaque ? Je ne le sus jamais, mais j'appris ensuite que ce ne fût pas le seul cas.
Nous étions poussés en avant, accompagnés par les aboiements de nos gardes, qui nous criaient des mots qui deviendraient familiers, par la suite : "Laus ! Erhaus ! Weiter ! Schneiller ! "
Nous arrivâmes enfin à Sarrebruck où nous fûmes parqués dans un stade déjà très peuplé. Combien étions nous, deux mille, peut-être plus ?
J'y retrouvais de nombreux hommes de ma compagnie, certains anciens du 153ème que les événements avaient rassemblés là.
Ici la situation était pire qu'à Bataville : la nourriture était encore plus rare et à cause sans doute de l'eau nous fûmes tous atteints d'une dysenterie monstre. Un officier de santé allemand venait examiner chaque jour les selles dans de gigantesques latrines, il ajustait son monocle pour mieux voir et repartait en criant :"Die armen teufeln" (Les pauvres diables). Là s'arrêtait sa thérapie : aucun soin, aucun médicament, il était dépassé par l"ampleur de l’événement.
Avec mes compagnons, nous en arrivions à la conclusion qu'ici nous allions crever comme des rats ! Dans notre désespoirs, certains pensaient même que c'était le but des allemands : nous pensions qu'ils en étaient capables après ce dont nous avions été témoins, d'abord les Polonais, ensuite les Noirs, enfin les Traînards. Aussi guettions nous la première occasion qui nous permettrait d'échapper à cet enfer.
Courrait un "bruit" qui cette fois allait se révéler exact, que des équipes de volontaires allaient être constituées. La plupart de mes compagnons furent d'accord avec moi pour accepter cette solution plutôt que de rester là. Aussi formai-je une équipe (il fallait environ deux cents hommes) en prenant en priorité ceux de mon bataillon.
Il y eut une difficulté car je refusais d'en prendre deux avec lesquels j'avais déjà eu des problèmes de discipline car ne désirant pas renouveler des affaires d'autorité dans ce milieu carcéral où le moindre incident risquait de déraper de manière incontrôlable...
Sur promesse que leurs camarades se portent garant d'eux je me laisse finalement fléchir pour les embarquer avec nous : Avec la caution de leurs pairs, il n'y eut effectivement jamais plus de problèmes avec eux. Ces deux lascars étaient intelligents et cultivés mais corrosifs par leur perpétuelle contestation. Ils tournaient tout en en dérision et la moindre parole était prétexte à polémique : c'est cette attitude que je détestais (les étudiants crasseux !) Cette bombe désamorcée, ils ne me donnèrent jamais l'occasion de rappeler nos conventions. Mieux, quand ils projetèrent de s'évader, ils m'offrirent de partir avec eux. Je leur expliquais qu'à ce moment là, je n'étais pas encore prêt : il n'insistèrent pas, mais je leur signifiais que leur offre me faisais grand plaisir. Je me plaisais à penser qu'ils n'avaient pas garder mauvais souvenir de ma façon d'exercer mon autorité...
Nous fûmes donc embarqués, en camions cette fois, vers un endroit assez désert où plusieurs baraques avaient été édifiées.
C'était de camp d'Hilsbach (stalag XII B) dépendant de Hombourg au pied du mont Tunus non loin de Kaiseslautern, là même où mon père avait cantonné en 1919 lors de l'occupation de la Sarre...
Ce camp comprenait sept baraquements disposés en rectangle : le magasin à vivre, le logis des gardiens, le bureau d'administration, la garde (wache), un pour les sous-officiers prisonniers, et trois pouvant recevoir chacun une centaine d'hommes.
Une double ceinture de barbelés entourait le tout. Au milieu du chemin de ronde entre les deux clôtures patrouillaient les gardiens accompagnés de chiens loups (dits bergers allemands !)
Des lavabos, constitués de deux planches clouées en forme d'auget et alimentés par un tuyau percé de trous tous les quatre-vingt centimètres étaient implantés au milieu de la grande cour centrale.
Les baraque comprenaient des lits à trois niveaux garnis de paillasses en fibres de papier tissées emplies de fibre de bois. Au bout de quelques nuits cette fibre de bois devenait dure comme un bloc! Un sac à viande de toile grossière et une couverture (le luxe!) complétait notre couchage.
L'officier qui commandait le camp était un brave pépère qui avait fait la guerre de 14 ; notre plus grande surprise fût d'entendre le feldwebel nous interpeller en argot :"alors les mecs, vos crèches ne sont pas trop dégueulasses ?" Nous finîmes par apprendre qu'il avait été garçon de café à Pigalle !
Nos gardiens étaient pour la plupart de gros paysans du Brandebourg assez lourdauds auxquels nous avions rapidement des surnoms : Nounours, ou Perroquet du fait de son nez rouge et crochu...Un autre sortait de l'ordinaire : "Singer", le chanteur. Ce berlinois très bel homme avait par ailleurs des dons pour le Bel Canto, dommage que seul parmi nos gardiens, il fût nazi ! Nous pûmes constater qu'il faisait la pluie et le beau temps dans le camp, simple caporal, dictant parfois sa conduite à l'officier du camp. En fait tous avaient peur de lui.
Un autre cas remarquable : Muller, fraîchement incorporé dans la Wehrmacht ce jeune nancéien parlant mieux le français que l’allemand, à la déclaration de guerre avait suivi sa mère allemande dans son pays tandis que son frère aîné était resté en France avec son père.
Nos gardiens nous expliquèrent au fil des jours, qu'ils devaient leur affectation à la garde de ce camp, équivalent à du repos, du fait qu'ils avaient été très éprouvés lors de la campagne de Pologne à cause de l'irréductibilité des polonais. Ceux-ci, à les entendre, y compris les femmes, achevaient les blessés, tuaient le soldats pendant leur sommeil, etc...
Nous fûmes emmenés aux douches dans un village voisin et pendant que nous attendions en plein air, nus comme de vers, nos effets étaient ébouillantés.
Mais peu à peu des pièces d'uniformes très défraîchies et passablement usées nous furent distribuées, provenant des armées polonaises, autrichiennes, tchèques...Pour ma part, j'héritais d'un calot allemand et d'une veste tchèque de laquelle je m’empressais de découdre "le corbeau" (les aigles hitlériennes)
On nous vendit tout un ravitaillement d'articles de première nécessité raflés dans les Prisunics de la zone frontalière : fils aiguilles, rasoirs, brosses à dents, j'y trouvais même un agenda pour 1941 !
Chacun reçut aussi une petite cuvette en fer émaillé, en guise d'assiette...
La bureaucratie ne perdant jamais ses droits, nous fûmes enregistrés et immatriculés et on nous remis un ticket vert portant notre numéro qui devait être exhibé à toute réquisition.
Mais on nous informa que notre travail serait rémunéré : dix huit pfennigs par jour ! En effet à la fin du mois nous reçûmes une feuille de paie en bonne et due forme ! Sauf que l'on pouvait constater qu'on nous retenait trente jours de nourriture, les frais de logement et d'habillement...Oubliant, sans doute par manque d'imagination, de nous retenir des frais de gardiennage...Toujours est-il qu'il nous restait en fin de compte dix-huit pfennigs pour salaire d'un mois, soit le fruit d'une journée de travail.
Cependant, la nourriture avait été améliorée : une boule de pain (non moisi) pour huit au lieu de douze et une distribution de margarine ou de marmelade. Un "café" au glands le matin et une soupe distribuée au retour le soir, constituait notre régime quotidien. Malgré ces améliorations, nous continuions d'être sous-alimentés. Les colis alimentaires envoyés par nos familles qui finirent par nous parvenir environ huit ou dix mois après notre arrivée ne parvinrent pas à compenser la légèreté de ce régime.
Il faut souligner que cette nourriture essentiellement ultra-liquide joua plus d'une fois des tours à certains lors des nuits avec réveil en sursaut dû à une humidité accidentelle...
Notre première expérience de travail volontaire ne fût pas un franc succès ! Notre tâche devait consister à aplanir le terrain devant les créneaux des casemates de la ligne Siegfried. Nous fîmes valoir que cela était en désaccords avec les conventions de Genève qui interdisaient que l'on utilise les prisonniers à tout travail à des fins militaires. Par ailleurs nous considérions que la tâche des sous-officiers consistait juste à encadrer leurs hommes, tandis que les allemands prétendaient leur faire prendre la pelle et la pioche. Le responsable de l'organisation Todt à qui nous avions été affecté écumait de rage durant ces longues palabres en vue de faire aboutir nos revendications. En fin de compte, nous obtinrent gain de cause, et l'on nous affecta au remblaiement des tranchées que les civils avaient creusé dans leurs cours ou jardins
J'avais demandé aux gars qui travaillaient en petits chantiers de me rapporter tous ce qu'ils pourraient observer d'insolite ou d'inhabituel, pouvant servir de renseignement et confronter les indices ainsi récoltés. Outre nos cinq cents paires d'yeux et d'oreilles, nos informations venaient de commandos qui travaillaient dans les fermes écoutant ainsi de temps en temps radio-Londres, parfois même les infos provenaient de paysans allemands, et puis il y avait l'ami Muller mentionné plus haut !
Tout cela nous permit d'apprendre à nos gardiens, souvent plusieurs jours avant qu'ils ne lisent dans leur journal :
le 7 septembre 40, l'état des pertes allemandes d'avions au-dessus de l'Angleterre
le 21 janvier 41 la prise de Tobrouk par les britanniques
le 10 mai 41 la fuite de Rudolf Hess en Angleterre
le 22 juin 41 la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Russie
début juillet 41, arrivée de premières forteresses volantes en Islande (NdR : je n'ai pas trouvé de référence sur cet événement)
Des fouilles au peigne fin s'ensuivirent, nos gardiens sondaient planchers, plafonds et parois de nos baraques espérant y découvrir un poste radio clandestin !
Les fouilles à corps avaient lieu très souvent, à toute heure et en tout lieu. Étaient prohibés : rasoirs à main, armes, briquets, stylos, argent français ou allemand, etc. .. Suite à la rafle des briquets, le cuistot qui avait accès au bureau du feldwebel récupéra toutes les molettes, les rendant inutilisables.
Quant à nous, nous fîmes de l'étoupe : des lambeaux de draps de pans de capote enroulés dans une boite de cirage vide, bien refermée et mise au feu. Cela donnait de l'étoupe de première qualité ! Ensuite, une seule étincelle suffisait à faire rougeoyer toute la surface de la boite : voir la mine ahurie de nos gardiens quand on leur offrait du feu...
A propos de fouilles, il est remarquable que certain P.G. gardèrent jusqu'au bout des objets tels que stylos, argent, rasoirs à main, etc...Les meilleures cachettes étaient souvent celles les plus en vue, ainsi les chaussettes qui séchaient sur leur fil renfermaient bien des trésors ! Les boutons de capotes dessertis contenaient des billets de banque roulés en boulettes.
Un de mes collègues, l'adjudant Gérard, parvint même à subtiliser une paire de cisaille et un litre d'essence !
Cet adjudant Gérard était arrivé récemment avec un groupe de deux cents "bretons"! Nous convînmes d'un modus-vivendi : lui s'occuperait de ses gars, et moi des miens, après cela il n'y eu jamais de problèmes entre nous.
L’hiver suivant (41) fût d'une extrême rigueur. La neige abondante recouvrait tout, et nous fûmes requis pour déneiger un convoi de camions enfoui sous deux mètres de neige dans une route encaissée.
Tous les jours, debout à cinq heures, rassemblés ensuite en pleine nuit pour le comptage, puis cinq à six kilomètre de marche avec d'affreux sabots qui nous martyrisaient pieds et chevilles, nous arrivions sur le lieu de travail vers les sept heures trente. Nous y restions jusqu'à 17 heures trente avant le retour aux baraques.
Un jour, les allemands nous annoncèrent que ceux qui le désiraient pourraient se rendre à la messe du dimanche. Nous fûmes tous volontaires ! Les schleus tentèrent-il de débusquer les juifs parmi ceux qui n'iraient pas ? Nous les pensions en être bien capables...
L'attitude de nos gardiens fut choquante durant cette messe, où ils arpentaient le chœur en tout sens, arme à la main, martelant le dallage du talon de leurs bottes ferrées !
Le prêtre semblait apeuré. Il nous fit en allemand, puis en mauvais français un prône sur la nécessaire résignation de notre condition en expiation de nos fautes supposées...
Cette pénible expérience ne se renouvela pas : ceux d'entre-nous croyants, se contentaient d'une prière commune le dimanche.
Le 11 Novembre nous fîmes une minute de silence à onze heure...J'avais eu beau prévenir nos gardes, ils ne comprenaient rien à cette histoire de 11 Novembre : ils n'en avaient jamais entendu parler ! Quand je donnait le coup de sifflet et que tous les P.G. se figèrent au garde-à-vous, les gardes s'affolèrent nous menaçant de leurs armes pour nous faire reprendre le travail. Quand au deuxième coup de sifflet tous les P.G. reprirent le travail, les sentinelles se ruèrent sur moi en me menaçant pour ne pas recommencer !
Début janvier, sur mon petit agenda j'écrivis :" 41 commence mal, mais finira mieux". Un petit message à usage personnel pour me remonter le moral !
En cette fin janvier, l'équipe qui nous gardait fut relevée par un contingent composé en majorité d'autrichiens. Nous fûmes ébahis par la différence de comportement de nos nouveaux gardiens : plus gais, ne se fâchant pas, sans les brutalités si habituelles des précédents, le Perroquet, Nounours, Singer et consorts...
Grâce à certains de ces nouveaux gardes, l' échange d'argent fut rendu possible de même que certains achats en ville !
Leur chef était un jeune lieutenant très sympathique. Il nous accompagnait chaque jour sur notre lieu de travail. Il discutait de façon très décontractée et nous appris qu'il était le fils d'un constructeur d'avions dont la firme avait été réquisitionnée pour l'effort d'armement. Lui-même pilotait un petit appareil personnel dont il nous montra les photos. Il n'hésita pas par ailleurs à nous photographier avec son Leitz et à nous en offrir les épreuves.
Un matin il emmena quelques uns d'entre nous en camion dans une maison forestière où il avait de la famille : un confortable goûter nous y attendait ! Bien entendu le silence absolu nous était demandé et il ne serait venus à quiconque l'idée de déroger à la consigne… Au fil d'une conversation je lui demandais ce qu'il pensait du nazisme, réponse : « Chef, nous en reparlerons après la guerre, maintenant c'est un sujet trop dangereux, compris j'espère? ».
Malheureusement les meilleures choses étant fugitives, deux mois plus tard, « nos autrichiens » nous avertirent de leur prochain départ. Il furent relevés comme prévu par nos anciens gardiens : bonjour Nounours, Perroquet, Singer et les autres !
En mars 1941 nos travaux de terrassement consistaient à l'élargissement des routes.
Au hasard d'une corvée à Saint-Avold dont je faisais partie, nous pûmes constater qu'à plusieurs endroits, courettes, jardins, le linge qui séchait sur les cordes s'étalait en produisant ostensiblement les trois couleurs du drapeau, par exemple : un bleu de travail, un drap blanc, puis un tablier rouge… De plus les épouvantails à moineaux des jardins étaient rudement bien habillés : les candidats au voyages prirent bonne note…
En effet, en avril 1941, le 22, deux gars manquaient à l'appel, l'évidence était là : ils s'étaient évadés !
Cette date marqua le début d'une nouvelle époque dans la vie du camp : le temps des évasions.
Pour faciliter les futures et semblables entreprises, nous décidâmes, l'adjudant Gérard et moi d'aider les aspirants au départ.
Prochain volet de cette histoire : le temps des évasions...

 Se Connecter
Se Connecter




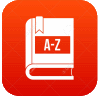

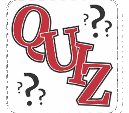





 Février 2016
Février 2016 Décembre 2015
Décembre 2015